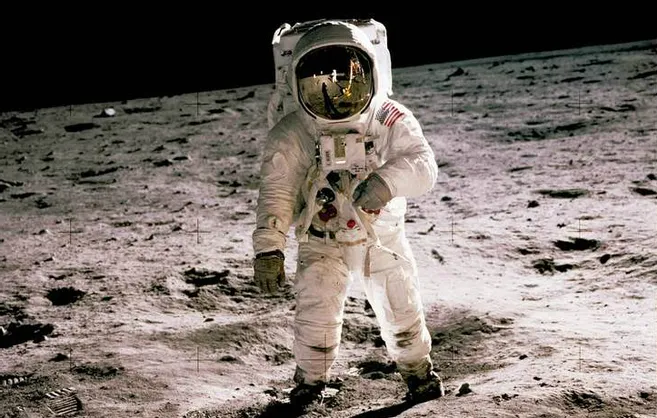C’est peu dire que la transposition du droit européen en matière de congés payés et d’arrêt-maladie ne fait pas que des heureux parmi les employeurs. Voici une explication importante sur la décision controversée de la Cour de Cassation.

I. Genèse d’un bouleversement en droit social : le contexte du revirement
Le droit français des congés payés a longtemps reposé sur un principe simple et immuable, souvent résumé par la formule « pas de travail effectif, pas de congés payés ». Ce principe trouvait sa source directe dans l’article L. 3141-3 du Code du travail, qui disposait que le salarié acquiert un droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de « travail effectif » chez le même employeur, dans la limite de 30 jours ouvrables par an.1 Conformément à cette disposition, les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour cause de maladie d’origine non professionnelle, n’étaient pas considérées comme du travail effectif et, par conséquent, n’ouvraient pas de droits à congés. Une exception, partielle et limitée, était prévue par l’article L. 3141-5 pour les absences dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT/MP), mais l’assimilation au temps de travail effectif était elle-même circonscrite à une période d’un an ininterrompu.1
Cette architecture juridique nationale s’est trouvée en opposition frontale avec les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), par une jurisprudence constante, a jugé que le droit au congé annuel payé, consacré par l’article 7 de la Directive 2003/88/CE et l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, constituait un principe essentiel du droit social.2 La finalité de ce droit n’est pas uniquement de permettre au travailleur de se reposer en compensation du travail fourni, mais aussi de lui offrir une période de détente et de loisirs afin de se remettre d’une éventuelle maladie. La Cour a estimé qu’une période d’incapacité de travail, étant « imprévisible et indépendante de la volonté du travailleur », ne pouvait priver ce dernier de son droit au congé annuel payé.2
Malgré cette position claire et réitérée de la CJUE, le législateur français n’a pas procédé à la modification des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail pour les mettre en conformité avec le droit européen. Cette inertie a créé un vide juridique persistant dans les relations de travail de droit privé. En effet, la directive européenne ne pouvant pas, en principe, être directement opposée à un employeur privé par un salarié, les juridictions françaises se trouvaient contraintes d’appliquer la loi nationale, même si celle-ci était contraire au droit de l’Union. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, saisie de plusieurs pourvois, a adopté une position qui s’apparente à un activisme judiciaire délibéré. Pour résoudre cette contradiction et assurer la primauté des droits fondamentaux de l’Union, elle a utilisé un instrument juridique puissant : l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Ce texte, qui bénéficie d’une valeur supérieure, est directement invocable dans les litiges entre particuliers. En choisissant d’écarter le Code du travail pour appliquer directement la Charte, la Cour de cassation a mis en œuvre le dispositif technique qui a radicalement transformé la jurisprudence française.
II. Le dispositif technique de la Cour de Cassation : le revirement du 13 septembre 2023
Le 13 septembre 2023 marque une date de rupture jurisprudentielle majeure en droit du travail français, avec la publication d’une série de trois arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 22-17.340 à 17.342, n° 22-17.638 et n° 22-10.529).1 Ces décisions constituent le cœur du dispositif technique retenu pour mettre le droit national en conformité avec le droit européen.
2.1. L’acquisition de congés payés pendant un arrêt-maladie (hors AT/MP)
Dans l’arrêt principal concernant la maladie d’origine non professionnelle (pourvois n° 22-17.340 à 17.342), la Cour de cassation a jugé que le droit au congé annuel payé ne pouvait pas être conditionné à l’exécution d’un travail effectif lorsque le salarié était en arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident.8 Le dispositif technique a consisté à écarter l’application de l’article L. 3141-3 du Code du travail, considérant sa non-conformité avec le droit européen. La Cour a fondé sa décision sur l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, affirmant que le juge national est tenu d’assurer la protection juridique découlant de ce texte, même dans les litiges opposant des parties privées.1 Il en a résulté la reconnaissance d’un droit pour le salarié d’acquérir des congés payés pendant son absence pour maladie, quelle que soit la durée de cette absence.
2.2. L’acquisition illimitée de congés en cas d’AT/MP
Dans une seconde affaire (pourvoi n° 22-17.638), la Cour de cassation a appliqué la même logique à l’article L. 3141-5 du Code du travail, qui limitait à un an l’assimilation des périodes d’arrêt pour AT/MP à du temps de travail effectif.1 La Haute Juridiction a déclaré cette limitation non conforme au droit de l’Union européenne, affirmant que le salarié en arrêt pour AT/MP acquiert désormais des congés payés pendant la totalité de la période de suspension de son contrat, sans limite de temps.1 Ce faisant, elle a non seulement confirmé la nouvelle approche pour la maladie ordinaire, mais a aussi levé une restriction jugée arbitraire pour les arrêts les plus longs, alignant pleinement le droit français sur les exigences européennes.
2.3. La redéfinition du point de départ de la prescription
Le troisième arrêt majeur de cette série (pourvoi n° 22-10.529) a abordé la question de la prescription pour les demandes de rappel d’indemnités de congés payés. Traditionnellement, le délai de prescription de trois ans pour les créances salariales (article L. 3245-1 du Code du travail) commençait à courir à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient dû être pris.1 La Cour de cassation a opéré un changement fondamental de ce mécanisme. Elle a jugé que le délai de prescription ne peut courir que si l’employeur a mis le salarié en mesure d’exercer son droit à congé en l’informant de ses droits de manière appropriée.1
Ce dispositif technique a des conséquences profondes. En liant le point de départ de la prescription à l’action d’information de l’employeur, la Cour a rendu la créance de congés payés virtuellement imprescriptible tant que l’employeur n’a pas rempli son obligation. Cela opère un renversement de la charge de la preuve : ce n’est plus au salarié de prouver qu’il n’a pas pu prendre ses congés, mais à l’employeur de démontrer qu’il a bien informé le salarié de ses droits et de la période de report. En l’absence de cette preuve, le risque financier pour les entreprises est potentiellement illimité dans le temps et s’étend de manière rétroactive. Cette jurisprudence a contraint les employeurs à une refonte de leurs processus internes et a servi de catalyseur à l’intervention du législateur.
III. La réponse législative : la loi n°2024-634 du 22 avril 2024
Le bouleversement jurisprudentiel de la Cour de cassation a rendu urgente une réponse législative pour clarifier et encadrer la situation. La loi n°2024-634 du 22 avril 2024, en modifiant les dispositions du Code du travail, a codifié une grande partie de la nouvelle jurisprudence tout en y apportant certaines spécificités.4
3.1. Les nouvelles règles d’acquisition
La loi a introduit de nouvelles règles d’acquisition des congés payés pendant les arrêts de travail, en distinguant deux régimes :
- Pour les arrêts-maladie d’origine non professionnelle : l’acquisition de congés payés est désormais un principe. Le salarié acquiert 2 jours ouvrables de congés par mois d’absence, soit un total de 24 jours ouvrables par période de référence (l’équivalent de quatre semaines, conformément au droit européen).4
- Pour les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP) : le salarié continue d’acquérir 2,5 jours ouvrables de congés par mois, soit 30 jours ouvrables par an.4 Le législateur a ainsi confirmé la position de la Cour de cassation en supprimant la limitation d’un an prévue par l’ancien article L. 3141-5 du Code du travail. Le salarié en arrêt pour AT/MP acquiert donc des congés payés pendant toute la période de son absence.9
3.2. Le régime de report et d’extinction des droits
La loi a également institué un régime précis pour le report des congés payés non pris en raison d’un arrêt de travail. Le salarié dispose désormais d’un délai de report de 15 mois pour prendre ses congés acquis pendant sa période d’absence.12 Ce délai ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle l’employeur a informé le salarié de ses droits, après sa reprise du travail.4 Cette obligation d’information est devenue un élément central de la gestion des congés. Le droit à congés payés peut s’éteindre à l’issue de ce délai de 15 mois si le salarié, dûment informé, n’a pas posé ses jours.4
3.3. Le régime de la rétroactivité et ses complexités
Le législateur a cherché à encadrer le risque financier lié à la rétroactivité de cette nouvelle règle. La loi a explicitement prévu que l’acquisition de 2 jours ouvrables par mois pour la maladie non professionnelle, les règles de report et l’obligation d’information s’appliquent de manière rétroactive aux périodes d’absence débutant depuis le 1er décembre 2009.4
Cependant, la loi a introduit une distinction qui a suscité une contradiction juridique. Elle exclut expressément la rétroactivité de l’acquisition des congés pour les arrêts pour AT/MP de plus d’un an intervenus avant le 24 avril 2024, date d’entrée en vigueur de la loi.13 Or, il est crucial de noter que la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2023, a fondé son raisonnement sur la non-conformité au droit de l’Union européenne, un principe supérieur. En conséquence, malgré la limitation législative, un salarié en arrêt pour AT/MP avant le 24 avril 2024 reste en droit d’invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation et le droit de l’UE pour obtenir la régularisation rétroactive de sa situation.15 La loi n’a donc pas pu, en l’état, supprimer ce droit acquis en vertu de la jurisprudence, laissant subsister un risque juridique et financier pour les employeurs.
IV. Implications pratiques et opérationnelles
La mise en conformité du droit français a eu des répercussions immédiates et majeures pour les entreprises et leurs salariés.
4.1. Les nouvelles obligations des employeurs
La nouvelle donne juridique impose aux employeurs une gestion non plus seulement des droits, mais aussi des risques financiers. Ils sont désormais confrontés à la nécessité d’auditer et de régulariser les comptes de congés de leurs salariés, y compris pour des périodes d’absence passées remontant jusqu’à décembre 2009.4 En effet, tant que l’employeur n’a pas informé le salarié de ses droits, la prescription ne court pas. Cette obligation d’information est la clé de voûte du dispositif. Après chaque arrêt de travail, l’employeur doit informer le salarié de son nombre de jours de congés acquis et de la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.11 Cette communication doit être faite par tout moyen traçable, tel qu’une lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre remise en main propre contre décharge, ou une mention sur le bulletin de paie.11 La simple délivrance d’un bulletin de paie ne peut pas être considérée comme une information suffisante si le décompte n’y est pas explicitement détaillé.10 Cette nouvelle exigence implique une révision complète des processus de paie et de gestion des absences, ainsi que des systèmes d’information, pour intégrer les nouvelles règles de calcul et de report.1
4.2. Les droits nouveaux pour les salariés
Les salariés ont désormais des droits étendus, à la fois pour le futur et pour les périodes d’absence passées.10 Ils peuvent demander la régularisation de leurs droits à congés pour des périodes d’arrêt-maladie antérieures. Si le salarié est toujours en poste, cette régularisation prend la forme de jours de congés supplémentaires à prendre. Si son contrat de travail a été rompu, il peut réclamer une indemnité compensatrice de congés payés, correspondant aux jours acquis et non pris à la date de la rupture.4 Le délai de prescription pour une telle action est de trois ans et court à compter de la date de la rupture du contrat de travail.4
V. Synthèse technique et recommandations opérationnelles
Le tableau ci-dessous offre une synthèse comparative des différentes phases du droit des congés payés pendant un arrêt-maladie, de l’ancien régime aux nouvelles dispositions législatives, en passant par le tournant jurisprudentiel.
| Caractéristique | Régime Ancien (avant 13/09/2023) | Régime Jurisprudentiel (13/09/2023) | Régime Législatif (Loi 22/04/2024) |
| Maladie ordinaire | Aucune acquisition | Acquisition sans limite de durée | Acquisition de 2 jours ouvrables/mois, dans la limite de 24 jours/an 11 |
| AT/MP | Acquisition limitée à 1 an 1 | Acquisition sans limite de durée 1 | Acquisition de 2,5 jours ouvrables/mois, sans limite de durée 11 |
| Point de départ de la prescription | À l’expiration de la période de prise des congés 9 | Lorsque l’employeur a informé le salarié de ses droits 10 | Lorsque l’employeur a informé le salarié de ses droits 13 |
| Report des congés | Non automatique | Obligation de report 10 | Délai de report légal de 15 mois 13 |
| Rétroactivité | Non applicable | Oui, fondée sur le droit de l’UE 15 | Oui, jusqu’au 01/12/2009 pour la maladie ordinaire.4 Non pour les AT/MP d’une durée > à 1 an avant 24/04/2024, mais la jurisprudence reste applicable 13 |
5.2. Exemples de calcul pour différents scénarios
Pour un salarié qui aurait été absent pour maladie non professionnelle du 1er août au 30 septembre 2024 (soit deux mois) sur une période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 11 :
- Période du 1er juin au 31 juillet 2024 : il acquiert 2 mois * 2,5 jours = 5 jours.
- Période du 1er août au 30 septembre 2024 (maladie) : il acquiert 2 mois * 2 jours = 4 jours.
- Période du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025 : il acquiert 8 mois * 2,5 jours = 20 jours.
- Total des congés acquis : 5 + 4 + 20 = 29 jours ouvrables.
5.3. Recommandations détaillées pour la mise en conformité
Compte tenu de la complexité de cette nouvelle réalité juridique, les employeurs doivent agir de manière proactive pour limiter leurs risques financiers :
- Audit interne : procéder à un audit exhaustif des fiches de paie et des dossiers du personnel pour identifier les salariés qui, depuis le 1er décembre 2009, ont eu des périodes d’arrêt-maladie non indemnisées en congés payés.
- Mise à jour des systèmes d’information : les logiciels de paie et de gestion RH doivent être rapidement mis à jour pour intégrer les nouvelles règles de calcul différenciées (2 jours vs. 2,5 jours) et le mécanisme de report de 15 mois.
- Établissement d’un protocole d’information : il est impératif de mettre en place un processus systématique et traçable de communication des droits à congés payés à tous les salariés, à l’issue de chaque arrêt de travail. Cette information doit être explicite et distincte, précisant le nombre de jours acquis et la date limite de leur prise.
- Exploration des accords d’entreprise : la loi laisse la possibilité, par accord collectif, d’augmenter la durée de la période de report au-delà des 15 mois 16, ce qui peut être un outil de gestion pour l’employeur.
Conclusion
Par un revirement audacieux fondé sur un dispositif technique novateur, la Cour de cassation a forcé la mise en conformité du droit du travail français avec les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, mettant fin à un paradoxe juridique de longue date. La loi du 22 avril 2024 a en partie codifié ces principes, apportant une réponse à l’incertitude générée par la jurisprudence. Cependant, elle n’a pas totalement levé les ambiguïtés, notamment en ce qui concerne la rétroactivité des congés acquis pendant les arrêts de longue durée pour AT/MP. En conséquence, si le droit des salariés à acquérir des congés payés pendant un arrêt-maladie est désormais un principe acquis, la charge de la preuve et la gestion du risque financier pèsent lourdement sur les employeurs. Ces derniers doivent désormais adopter une approche proactive, passant d’une simple application des règles à une gestion stratégique de leur conformité juridique.
Sources des citations
- La Cour de cassation confirme le droit de l’Union européenne : le …, consulté le septembre 11, 2025, https://www.seban-associes.avocat.fr/la-cour-de-cassation-confirme-le-droit-de-lunion-europeenne-le-salarie-acquiert-des-conges-payes-pendant-un-arret-pour-maladie-dorigine-non-professionnelle/
- Revirement de jurisprudence relatif aux congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie, consulté le septembre 11, 2025, https://kpmg.com/av/fr/avocats/eclairages/2023/09/revirement-de-jurisprudence-les-periodes-passees-en-conge-maladie-ouvrent-droit-aux-conges-payes.html
- La nouvelle jurisprudence sur les congés payés complique la clôture des comptes, consulté le septembre 11, 2025, https://www.editions-legislatives.fr/actualite/la-nouvelle-jurisprudence-sur-les-conges-payes-complique-la-cloture-des-comptes/
- Congés payés pendant un arrêt de travail : présentation des …, consulté le septembre 11, 2025, https://www.acg-avocat.com/actualites-juridiques/conges-payes-pendant-un-arret-de-travail-presentation-des-nouvelles-regles.html
- 62011CJ0078 – EN – EUR-Lex – European Union, consulté le septembre 11, 2025, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62011CJ0078
- Report des droits à congés payés en cas d’arrêt maladie pendant ses congés… – UNSA, consulté le septembre 11, 2025, https://www.unsa.org/Report-des-droits-a-conges-payes-en-cas-d-arret-maladie-pendant-ses-conges.html
- La Cour de cassation ouvre la porte à l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie | Service-Public.fr, consulté le septembre 11, 2025, https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16756
- www.village-justice.com, consulté le septembre 11, 2025, https://www.village-justice.com/articles/conge-paye-qui-change-pour-les-salaries-apres-les-arrets-septembre-2023,47400.html#:~:text=Dans%20cet%20arr%C3%AAt%20du%2013,ou%20%C3%A0%20une%20maladie%20professionnelle.
- Congé payé : ce qui change pour les salariés après les 3 arrêts du 13 septembre 2023, consulté le septembre 11, 2025, https://www.village-justice.com/articles/conge-paye-qui-change-pour-les-salaries-apres-les-arrets-septembre-2023,47400.html
- Congés payés : les conséquences des arrêts du 13 septembre 2023 – Groupe 3E, consulté le septembre 11, 2025, https://www.groupe3e.fr/conges_payes_les_consequences_des_arrets_du_13_septembre_2023
- Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie : les …, consulté le septembre 11, 2025, https://code.travail.gouv.fr/information/acquisition-de-conges-payes-pendant-un-arret-maladie-les-nouvelles-regles
- Récupérer les congés payés sur maladie : les règles enfin fixées – Cadre Averti, consulté le septembre 11, 2025, https://www.cadreaverti-saintsernin.fr/actualites/conges-payes-maladie-regles-fixees-243.html
- Un salarié peut-il acquérir des congés payés pendant un arrêt …, consulté le septembre 11, 2025, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F37482
- Congés payés : pas de rétroactivité pour les arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle – Petrel Avocats, consulté le septembre 11, 2025, https://www.petrel-avocats.com/fr/conges-payes-pas-de-retroactivite-pour-les-arrets-lies-a-un-accident-du-travail-ou-une-maladie-professionnelle/
- Ressources humaines -Arrêt maladie longue durée : le salarié peut obtenir rétroactivement une indemnité de congés payés couvrant l’intégralité de son arrêt | Service-Public.fr, consulté le septembre 11, 2025, https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A17828
- Congés payés et maladie : les nouvelles règles légales entrent en vigueur ce 24 avril, consulté le septembre 11, 2025, https://formation.lefebvre-dalloz.fr/actualite/conges-payes-et-maladie-les-nouvelles-regles-legales-entrent-en-vigueur-ce-24-avril