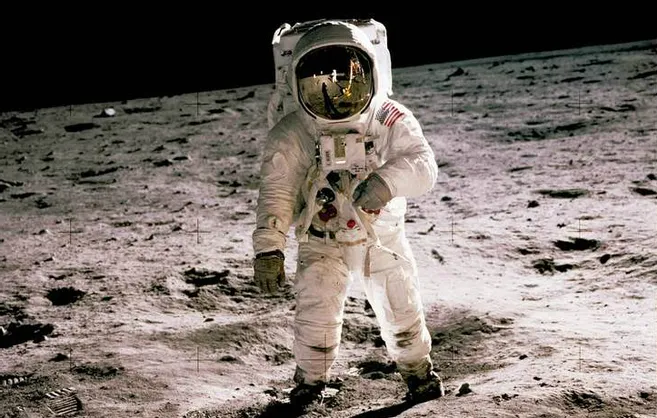Le dialogue social au sein d’une organisation se réclamant de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est, en théorie, fondé sur des principes de participation, de solidarité et de gouvernance démocratique. C’est pourquoi la récente crise qui a secoué la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), un acteur historique et emblématique de ce secteur, soulève des questions fondamentales.
L’annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) par le Conseil d’État, couplée à la création d’une section syndicale CGT au sein du siège de la fédération, révèle une dégradation profonde des relations entre la direction et le personnel. Ces événements ne sont pas de simples incidents isolés, mais les symptômes d’une déconnexion significative entre les valeurs affichées de la Mutualité et ses pratiques de gestion. Ce rapport se propose d’analyser en profondeur les facteurs qui expliquent cette situation, en examinant les manquements juridiques, les dynamiques sociales sur le terrain, et les contradictions inhérentes à un modèle de l’ESS mis à l’épreuve des réalités économiques.
Partie I : L’annulation du PSE par le Conseil d’État : une défaillance juridique révélatrice
Le conflit social qui a éclaté au sein de la FNMF a atteint une dimension juridique majeure avec l’intervention de la plus haute juridiction administrative française. Le dénouement judiciaire d’un tel litige est souvent le reflet le plus formel des échecs du dialogue social en amont, révélant des failles dans la procédure et dans le fond des mesures proposées par la direction.
1.1. Le contexte et les motifs du PSE de la FNMF : la genèse d’un conflit annoncé
Le conflit a pris sa source avec l’annonce d’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi, qualifié de « séisme » par les représentants du personnel dans le monde mutualiste. Le plan prévoyait la suppression de 85 emplois sur un effectif de 250 salariés à la fédération, tout en annonçant la création de 25 nouveaux postes. La direction a justifié ce projet par la nécessité de faire face à une situation de déficit et de retrouver un équilibre financier d’ici 2027, conformément à une décision de son conseil d’administration.
Cependant, cette justification a été vivement contestée par les représentants du personnel, qui ont qualifié le projet de « précipité » et « injustifié ». Ils ont soulevé une contradiction dans la démarche, pointant le fait que les difficultés financières de la fédération étaient considérées comme « passagères » et que l’horizon de 2027 laissait largement le temps de s’organiser différemment. Ils ont notamment suggéré une gestion des départs naturels en retraite, prévus à hauteur d’une quarantaine d’ici 2027, comme une alternative moins brutale aux licenciements. Cette opposition frontale s’est manifestée par une mobilisation symbolique forte dès la première réunion du Comité Social et Économique (CSE), les salariés s’étant vêtus de rouge, « rouge comme la colère et la couleur mutualiste », pour exprimer leur désapprobation.
1.2. La décision du Conseil d’État : une analyse des manquements juridiques probables
Le postulat selon lequel l’annulation du PSE de la FNMF serait liée à un arrêt précis du Conseil d’État (n° 463870 du 27 juin 2025) nécessite une clarification critique. Les documents de référence indiquent que cet arrêt, bien que riche en enseignements sur l’annulation des PSE, concerne en réalité une « société du secteur logistique » et non la FNMF. L’importance de ce cas d’espèce ne réside donc pas dans son application directe à la FNMF, mais dans sa valeur d’exemple, car il met en lumière les motifs les plus fréquents de censure des PSE par le juge administratif. L’analyse des manquements reprochés à la société logistique fournit un éclairage puissant sur les défaillances probables du plan de la FNMF.
Les motifs d’annulation de l’homologation d’un PSE par la juridiction administrative se concentrent généralement sur deux aspects principaux : le caractère insuffisant du plan et les manquements procéduraux. Premièrement, le Conseil d’État rappelle la nécessité de vérifier l’adéquation du PSE aux moyens du groupe auquel appartient l’entreprise. Le plan de reclassement et les mesures d’accompagnement (formation, aide à la mobilité, aide à la création d’entreprise) doivent être suffisants et ambitieux compte tenu de la situation financière globale du groupe. Si un employeur, même en difficulté, appartient à un groupe économiquement solide, il ne peut pas se contenter d’un plan minimaliste. Deuxièmement, les manquements à la procédure de consultation du CSE constituent une cause majeure d’annulation. L’arrêt du 27 juin 2025 a notamment sanctionné un employeur qui n’avait laissé s’écouler que sept jours entre deux réunions du CSE, au lieu des quinze jours requis par la loi. Cette violation d’un délai légal, même pour des modifications mineures d’un plan, est jugée suffisante pour annuler la procédure d’homologation. La consultation du CSE doit être substantielle, permettant aux représentants du personnel de formuler des propositions que l’employeur doit « mettre à l’étude » et auxquelles il doit apporter une « réponse motivée ».
L’annulation du PSE de la FNMF, si elle s’est produite sur ces bases, n’est pas un simple accident de droit ; elle est la manifestation formelle de l’échec du dialogue social en amont. Un employeur pressé par ses impératifs de calendrier (un retour à l’équilibre pour 2027) pourrait avoir tenté d’accélérer la procédure de consultation, ne laissant pas aux représentants du personnel le temps de formuler des contre-propositions. La violation du cadre légal minimal du dialogue social est une preuve irréfutable de l’absence de volonté de négocier et d’écouter, ce qui a inévitablement conduit à la rupture de la confiance et au recours au juge administratif.
De plus, une annulation pour insuffisance de moyens serait particulièrement paradoxale pour une organisation de l’ESS. Par définition, l’économie sociale et solidaire repose sur l’affectation majoritaire des bénéfices au maintien ou au développement de l’activité, et sur le caractère impartageable des réserves obligatoires, le but n’étant pas le seul partage des bénéfices. Si le PSE de la FNMF a été jugé insuffisant, cela implique que l’organisation, qui gère des fonds et des réserves destinées à l’intérêt général (protéger ses adhérents), a été jugée incapable de fournir un plan de reclassement adéquat pour ses propres salariés. Cela met en lumière une contradiction profonde entre sa responsabilité sociale externe (vis-à-vis des adhérents) et sa responsabilité sociale interne (vis-à-vis des salariés), un paradoxe qui a sans doute alimenté le sentiment de trahison du personnel.
Partie II : La crise du dialogue social vue du terrain : entre mobilisation et réalignement syndical
Au-delà des aspects juridiques, la dégradation du dialogue social s’est manifestée par des signes concrets sur le terrain, culminant dans une mobilisation forte et un réalignement stratégique des représentants du personnel. Ces événements reflètent une perte de confiance généralisée et une perception de l’incapacité de la direction à gérer la situation de manière cohérente avec les valeurs de l’organisation.
2.1. Les signes avant-coureurs d’un dialogue social dégradé : une perte de confiance généralisée
La contestation a démarré dès le début de la procédure de consultation du CSE en mars, avec une mobilisation symbolique et visible des salariés. Le fait que les employés aient choisi le rouge, couleur de la « colère » et de la « mutualiste », est une déclaration puissante. Ce geste ne traduisait pas une simple désapprobation technique du plan, mais une blessure plus profonde : il s’agissait d’une « guerre civile » idéologique, où le personnel a utilisé la couleur de l’institution pour signifier que la direction avait trahi les valeurs fondatrices de la Mutualité elle-même.
Les représentants du personnel du CSE ont dénoncé un plan « brutal, injuste et violent », des termes qui témoignent d’une rupture émotionnelle et d’une absence de considération pour la dimension humaine de la restructuration. Ils ont pointé du doigt un « manque de soutien » de la direction, ainsi qu’une politique salariale jugée « injuste et opaque ». Ces doléances dépassent le simple cadre du PSE et indiquent une détérioration plus large des relations de travail, où la méfiance domine et où les contentieux sont nombreux, comme le dépeignent les experts en relations sociales pour les entreprises en crise.
2.2. La création de la section CGT : un choix stratégique face au rapport de force
La création d’une section CGT au siège de la fédération est une conséquence directe de la dégradation de ce climat social. Il ne s’agit pas d’un phénomène ex nihilo, mais du ralliement de la délégation préexistante « Sud Mutualité » à une organisation syndicale perçue comme plus puissante et mieux implantée dans le secteur.
Ce choix stratégique est révélateur. Les représentants du personnel ont estimé qu’ils ne pouvaient plus faire face seuls au rapport de force imposé par la direction. Le ralliement à la CGT a été motivé par la recherche de « moyens plus importants » et d’un « appui de la Fédération » pour « batailler encore plus avec l’employeur » et « faire respecter [leurs] droits ». Cela montre que le dialogue social avait déjà atteint un stade de blocage si avancé que la délégation a abandonné l’espoir d’un accord constructif pour se préparer à un affrontement plus direct. La création de la section syndicale est le symptôme, et non la cause, de la crise du dialogue social. Elle est la réaction d’employés qui ont perçu le plan social comme un acte de « violence » et ont cherché une force pour y opposer une résistance proportionnelle.
Partie III : Le choc des modèles : l’ESS face à ses contradictions
La crise à la FNMF ne peut se comprendre sans une analyse du conflit idéologique qui oppose les principes théoriques de l’Économie Sociale et Solidaire aux réalités de la gestion d’entreprise. La FNMF s’est retrouvée prise dans ce choc des modèles, révélant la fragilité d’un dialogue social fondé sur des valeurs lorsque celles-ci sont bousculées par la pression économique.
3.1. Les principes théoriques de l’économie sociale et solidaire : une fondation idéologique forte
La loi du 31 juillet 2014 a solidifié les fondations de l’ESS autour de trois principes fondamentaux : un but autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique qui assure la participation des parties prenantes, et une lucrativité limitée. Ces principes sont censés permettre une autre forme d’entreprendre, axée sur l’utilité sociale et la solidarité.
Historiquement, la Mutualité est l’une des incarnations les plus anciennes et les plus importantes de ce modèle, reposant sur une tradition de « solidarité » et d’ »indépendance ». Elle s’est construite sur la protection sociale en l’absence de l’État au XIXe siècle et a poursuivi son action tout en s’adaptant à l’évolution du système, notamment avec la création de la Sécurité sociale en 1945. Son positionnement public est celui d’un acteur majeur et d’un défenseur de la protection sociale, comme en témoigne la publication d’un manifeste pour « refonder le système de santé et de protection sociale ».
3.2. L’ESS à l’épreuve de la réalité : l’idéal bousculé par la gestion
Malgré ses principes, le secteur de l’ESS n’est pas à l’abri des réalités économiques. La FNMF a invoqué un déficit financier comme justification de son PSE. De manière plus générale, le secteur fait face à de nombreuses pressions, telles que la menace d’une taxe rétroactive sur les mutuelles , les difficultés budgétaires générales et le risque de suppression d’emplois liés à un manque de financement.
Le dialogue social dans l’ESS est marqué par la « coexistence entre militantisme et statut salarial » et se fonde sur des « valeurs partagées ». Cette particularité le rend potentiellement plus riche, mais aussi beaucoup plus fragile. La direction de la FNMF a opéré un choix managérial basé sur un modèle de gestion de crise traditionnel (restructuration brutale, suppression d’emplois) pour répondre à ses difficultés. Ce modèle est en contradiction frontale avec le modèle de l’ESS, qui repose sur la participation, le long terme et la solidarité. Cette dérive a créé un fossé abyssal avec des salariés qui, en tant que militants, attendaient une gestion alignée sur les valeurs affichées par l’organisation. La dissonance cognitive entre le discours public de la FNMF (défense de la solidarité et de la protection sociale) et son comportement en interne (plan social « brutal » et « injuste ») a généré un sentiment de trahison profonde et d’hypocrisie. L’organisation s’est présentée comme le « gardien de la protection sociale » face à l’État, tout en étant perçue comme « enterrant son propre modèle de solidarité » en interne.
Le tableau ci-dessous illustre le choc des modèles qui a provoqué la crise de la FNMF.
| Principes théoriques de l’ESS | Posture et discours publics de la FNMF | Pratiques de gestion constatées à la FNMF |
| Gouvernance démocratique : Participation des parties prenantes. | Un manifeste pour « refonder le système de santé » et « co-construire l’avenir de la protection sociale ». | Un plan de sauvegarde de l’emploi jugé « précipité » et « brutal » par le CSE. Annulation probable pour non-respect des délais de consultation. |
| Utilité sociale et Solidarité : Le but autre que le seul partage des bénéfices. Défense de la solidarité. | Défense du modèle de solidarité français. | Un plan social qui prévoit la suppression de 85 emplois. Dénoncé par les salariés comme « injuste et violent ». |
| Réinvestissement des bénéfices : Affectation des excédents au développement de l’activité. | La Mutualité « souhaite contribuer aux réflexions sur l’avenir du système de protection sociale ». | Le PSE a été jugé insuffisant au regard des moyens du groupe, impliquant que l’organisme n’a pas proposé assez de mesures de reclassement. |
Cette crise est un cas d’étude qui démontre la difficulté pour les organisations de l’ESS de maintenir un dialogue social de qualité lorsque les fondations idéologiques sont mises à l’épreuve par des contraintes économiques. Le « dialogue social » devient alors un simple « monologue de la direction », conduisant à la dénonciation du plan par les représentants du personnel, au recours au juge et, in fine, à une réorganisation du rapport de force syndical.
Conclusion : Le chemin de la reconquête d’un dialogue social authentique
La crise du dialogue social à la FNMF est le résultat d’une série de déconnexions fondamentales. Elle résulte d’une fracture entre une gouvernance de façade qui se veut démocratique et une prise de décision unilatérale et précipitée. Elle est aussi la conséquence d’une contradiction entre la posture publique de défense de la solidarité et une gestion interne perçue comme brutale et injuste. Enfin, elle incarne le choc entre les principes élevés de l’ESS et la réalité des impératifs économiques.
Pour la direction de la FNMF, la voie à suivre ne consiste pas en de simples ajustements techniques, mais en un réalignement stratégique et éthique. La reconquête d’un dialogue social authentique passe par plusieurs étapes cruciales. Il est d’abord impératif de reconnaître les manquements passés et de s’engager à co-construire un nouveau PSE avec les partenaires sociaux, en respectant scrupuleusement les délais légaux et en intégrant leurs propositions. Par ailleurs, la restauration de la confiance, profondément ébranlée, pourrait nécessiter le recours à une médiation externe. De telles démarches d’Appui aux Relations Sociales (ARS), encadrées par des tiers neutres, peuvent être la solution pour « dépassionner les propos » et « réinstaller la confiance » afin de dépasser les conflits et de travailler à des solutions durables. Enfin, la stratégie de restructuration elle-même doit être repensée pour être pleinement alignée sur les valeurs de l’ESS. Cela implique de privilégier des mesures de formation, de reclassement interne, et de capitaliser sur les départs naturels pour limiter le recours aux licenciements, et ainsi démontrer que la Mutualité n’est pas l’économie de la main tendue, mais l’économie de la poignée de main, y compris avec ses propres salariés.